
L'économie-modèle
Sans le savoir, nous sommes tous peu ou prou devenus au cours du temps les statistiques de modèles économiques divers et variés. PIB, taux de croissance, pourcentage d'étudiants, natalité, salaires : ces termes sans cesse rabâchés dans les médias nous sont devenus si familiers que nous en oublions passer régulièrement par la moulinette d'organismes comme l'INSEE (Institut Nationale de la Statistique et des Etudes Economiques) ou de l'OFCE (Observatoire Français des Conjonctures Economiques), et ce dans un but : prévoir nos comportements. En effet, quoi qu'on en dise, les décideurs politiques ne sont pas supposés prendre de décisions au hasard (osons le risque) et s'appuient sur un certain nombre d'études économiques visant à prévoir l'effet de telle ou telle mesure, jugée positive ou non. Malheureusement, les sciences économiques sont actuellement encore incertaines, et les événements restent trop souvent imprévisibles: cracks boursier ou politiques économiques, nous devons avouer une certaine impuissance dans notre incompréhension. Pourquoi nos modèles sont-il alors si inaptes à prévoir nos comportements et comment les améliorer ?
La prévision économique est présente dans la vie quotidienne de nombreux ingénieurs : que me coûtera ce pont ? Combien faire payer le péage ? Quel business model pour mon entreprise ? Quelle concurrence peut arriver sur mon marché ? Nous faisons tous des hypothèses, qui nous paraissent réalistes (et surtout permettent d'obtenir un résultat), pour nous aider à prendre des décisions. Mais comment comprendre le comportement d'un pays à partir de celui d'un individu typique ? Ce passage de la micro à la macro-économie est de plus en plus attaqué. Par exemple, les économistes néo-classiques font l'hypothèse que la courbe de demande d'un marché est la somme des courbes de demande individuelle de chaque consommateur (pour un physicien, cela reviendrait à expliquer le comportement d'une pierre à partir de celui d'un atome de carbone) ; le rôle de la monnaie est aussi négligé (marché à monnaie unique), ou encore les individus sont supposés rationnels. Si ces hypothèses paraissent simplificatrices à l'excès, elles sont pourtant régulièrement utilisées. D'une manière générale, les marchés sont supposés à l'équilibre, et y retournant en cas de perturbation, ce qui est absurde et incite à les considérer comme des systèmes dynamiques qui évoluent dans le temps(*) : ainsi peuvent être pris en compte des événements plus réalistes comme des variations brutales et locales, des changements de tendance ou de volatilité sur le long terme, etc.
Néanmoins, loin des modèles statistiques basiques, des chercheurs tentent de se rapprocher de la réalité avec une démarche qu'un physicien ne renierait pas : il s'agit de l'économie expérimentale. Plutôt que de supposer des comportements rationnels (individualisme, maximisation du profit, etc), le comportement réel d'individus comme vous et moi est étudié à travers des tests ou jeux. Les résultats sont surprenants à la fois par leur simplicité et l'abîme qui les sépare des hypothèses économiques : ils sont irrationnels au sens de la théorie économique ! Goût pour la coopération, jalousie, générosité, réciprocité, conformation aux normes sociales, la palette de nos réactions et motivations est immense. Ces "biais cognitifs" peuvent alors être compris et analysés pour la prévision de comportement collectifs. Un exemple frappant : le Royaume-Uni a choisi de lutter contre les retards de paiement en envoyant aux retardataires une lettre indiquant que presque tous les habitants de la commune avaient déjà payé, ce qui s'est traduit par une rentrée de 289 millions d'euros pour le Trésor britannique. A l'inverse, rémunérer le don du sang contribue à faire baisser le nombre de donneurs, car cela dégrade la satisfaction individuelle(**).
Il semble donc, à moins de faire tourner des ordinateurs dans le vent, que nos modèles économiques et financiers doivent être sérieusement revus. Plusieurs économistes, mathématiciens et physiciens se sont attelés à la tâche depuis de nombreuses années (Debreu, Sonnenschein, Giraud,etc), mais les modèles plus complexes peinent à prendre racine et restent cantonnés à des cercles bien limités, loin ou inaudibles des politiques, bien que parfois très anciens (voir par exemple les textes de Mandelbrot du début des années 60 sur les lois Lévy-stables et la répartition des revenus (***)). Si ces modèles peuvent paraître compliqués, il est nécessaire de les comprendre et les généraliser pour deux raisons. Tout d'abord, il s'agit de la stabilité du système financier : le cadre gaussien largement dépassé ne permet pas de comprendre les "crises" et, même si l'on est opposé à la finance spéculative, nous aimerions que nous institutions financières soient capables de se couvrir face à ce type de risque. D'autre part, ces outils sont indispensable à la mise en place de politiques publiques efficaces. Comment croire que se contenter de baisser telle ou telle charge suffira à faire revenir l'emploi, alors que nos émotions sont en jeu ? Et si placer l'humain au coeur de l'économie et de la politique était plus efficace que de scruter mois après mois l'évolution de courbes aux variations infinitésimales ?
(*) https://lejournal.cnrs.fr/articles/leconomie-malade-de-ses-modeles
(**) https://lejournal.cnrs.fr/articles/quand-leconomie-sinteresse-a-nos-comportements
(***) Benoît Mandelbrot, Fractales, hasard et finance, ed. Champs sciences
Le groupe Recherche
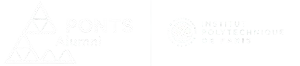



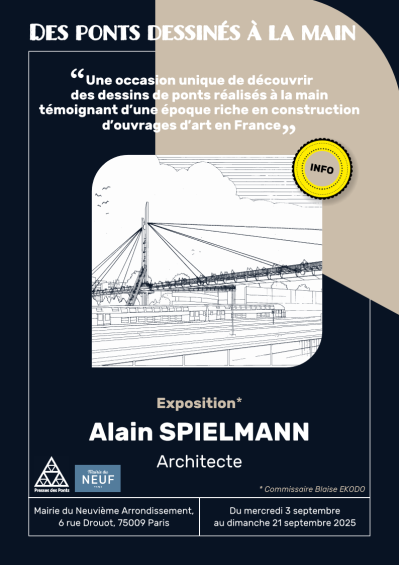

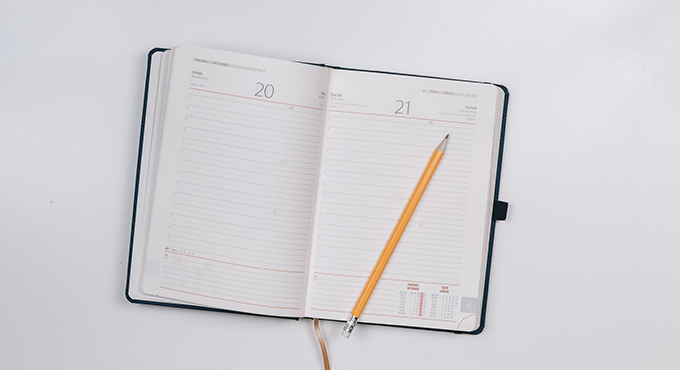
Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.